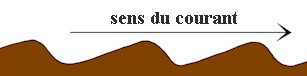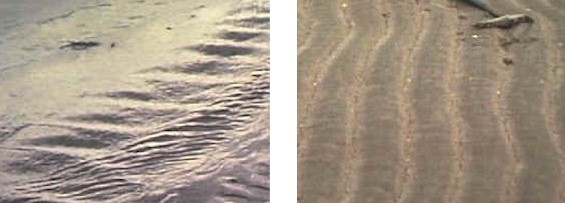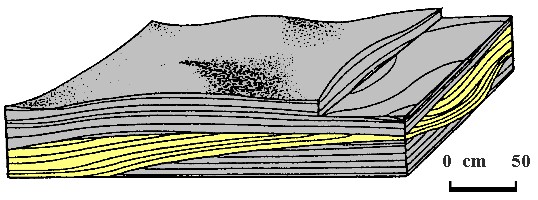Eléments de sédimentologie actuelle
Les figures
sédimentaires
Comme on peut le voir sur toute plage, le transport des particules
sédimentaires se traduit par un modelé particulier. Il en est de même à plus grande
profondeur, sous l’action des courants, des vagues, des tempêtes ou
d’événements plus énergétiques encore tels les tsunamis.
La reconnaissance de ces figures dans les séries sédimentaires est
importante et permet de se situer par rapport à une échelle basée sur le niveau
d’énergie appliqué au milieu de dépôt. On conçoit aisément que le niveau
d’énergie diminue avec la profondeur et/ou en fonction de la présence ou de
l’absence d’obstacles (barrière, herbier, récifs de toute nature …)
Le modèle couramment utilisé est basé sur la reconnaissance de
figures formées par l’action des vagues, de la houle et des tempêtes (tempestites).
Des exemples
1. Les
" petites " rides (échelle inframétrique)
Ces rides sont classiques de nos plages mais certaines sont formées à
plus grande profondeur.
a - Les rides asymétriques
Elles résultent de l’action d’un courant unidirectionnel
pouvant ou non interférer avec d’autres facteurs (distorsion d’une onde de
vague). L’évolution de ces structures est bien visible dans les
" ruisseaux " qui s’écoulent sur nos plages à marée
descendante. Ces rides se rencontrent dans tous les milieux (rivière ou mer) et à toutes
profondeurs. Leur dissymétrie permet de déterminer le sens du courant.
Rides asymétriques
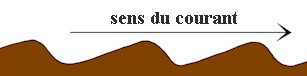
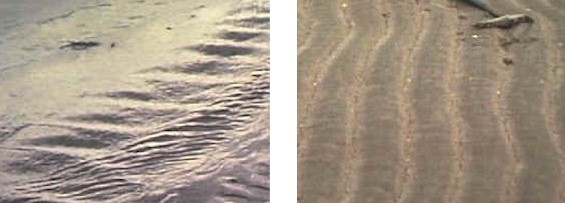
Ruisseau sur l'estran
Rides de courant sur la plage
b - Les rides symétriques
Elles sont formées par des courants oscillatoires sous l’effet de
la houle. Elles se rencontrent donc en front de plage, hors de la zone de déferlement des
vagues, et à profondeur relativement faible.
Rides symétriques

c - Les rides en mamelons
Elles sont caractérisées par la présence de petits dômes et de
dépressions distants de quelques centimètres à quelques décimètres. Elles sont
caractéristiques des dépôts de tempêtes.
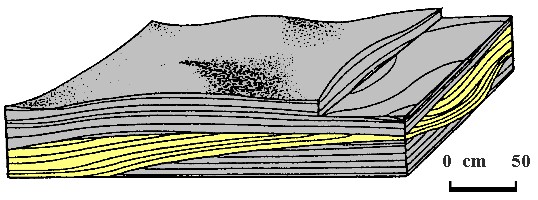
Rides en mamelons
(d'après SEDIMENTOLOGIE - Cojan - Renard
chez MASSON)
En coupe, elles montrent un litage oblique caractéristique faisant
apparaître des surfaces d’érosion qui traduisent le remaniement du sédiment sous
l’effet de l’intensité des courants qui règnent à la surface du fond lors des
tempêtes.
2. Les "grandes" rides
Dans les zones de haute énergie, sous l’effet des vagues et/ou
des courants, se forment des structures (rides, dunes) de grande taille dont
l’anatomie est marquée par des litages d’angle variable, obliques ou
entrecroisés. Les domaines de barrière (littorale ou plus distale) et les zones animées
par de forts courants (détroit de Pas de Calais, par exemple) sont le siège de ces
phénomènes. Dans les séries anciennes, de telles structures sont bien visibles dans les
calcaires ooïdiques du Dogger.
3. Les autres figures
a. Les tidalites
L’action des marées peut être caractérisée par des courants
d’intensité variable qui se renversent. La complexité du phénomène entraîne la
formation de figures marquées par une bidirectionnalité et la présence de nappages
argileux.
Tidalite dans le
Kimméridgien

b. Autres figures de tempêtes
Dans le Jurassique supérieur des falaises du Boulonnais on peut
observer, à différents niveaux, de minces bancs, lumachelliques, à base érosive,
interprétés comme des dépôts de tempêtes (Fursich et Oschmann 1986). Ces bancs
s’amalgament dans les régions proximales (moins profondes) et leur granulométrie et
épaisseur décroissent vers les régions distales (plus profondes).
L’action des organismes qui peuplent le fond marin (benthos) se
marque dans le sédiment. L’endofaune, en particulier par son activité de fouissage,
laisse une trace indélébile dans le sédiment, soit en l’homogénéisant
complétement, soit en laissant un réseau inextricable de pistes, galeries ou terriers.
Les organismes à l’origine de ces phénomènes sont rarement fossilisés mais
peuvent être identifiés dans les milieux actuels. Ce sont des vers, oursins, holoturies,
lamellibranches et divers crustacés.
Il est rarement possible d’observer ce réseau, excepté dans le
cas d’un substrat suffisamment ferme, comme en arrière du platier, au nord de
Calais, où une multitude de crabes utilisent un complexe de galeries qui restent
ouvertes. Elles sont partagées avec d’autres crustacés et petits poissons.
Dans les séries anciennes, cette bioturbation est parfois bien visible
au niveau de surfaces de ralentissement notable ou d’arrêt de la sédimentation,
tant dans le Jurassique que dans le Crétacé.
Rides et pistes dans le Tithonien

Retour Transport,
précipitation et sédimentation
Retour entrée GEOLOGIE du
BOULONNAIS